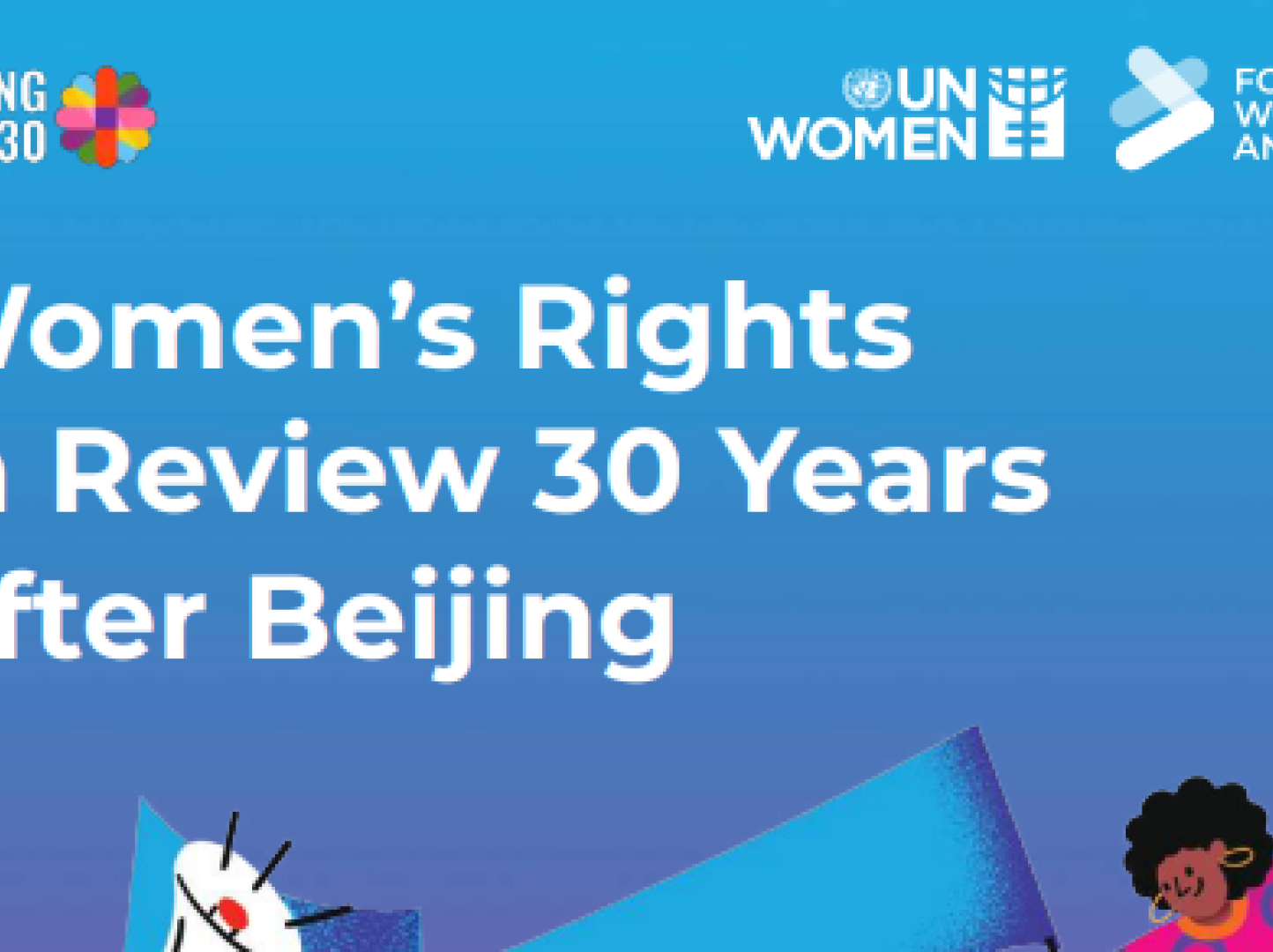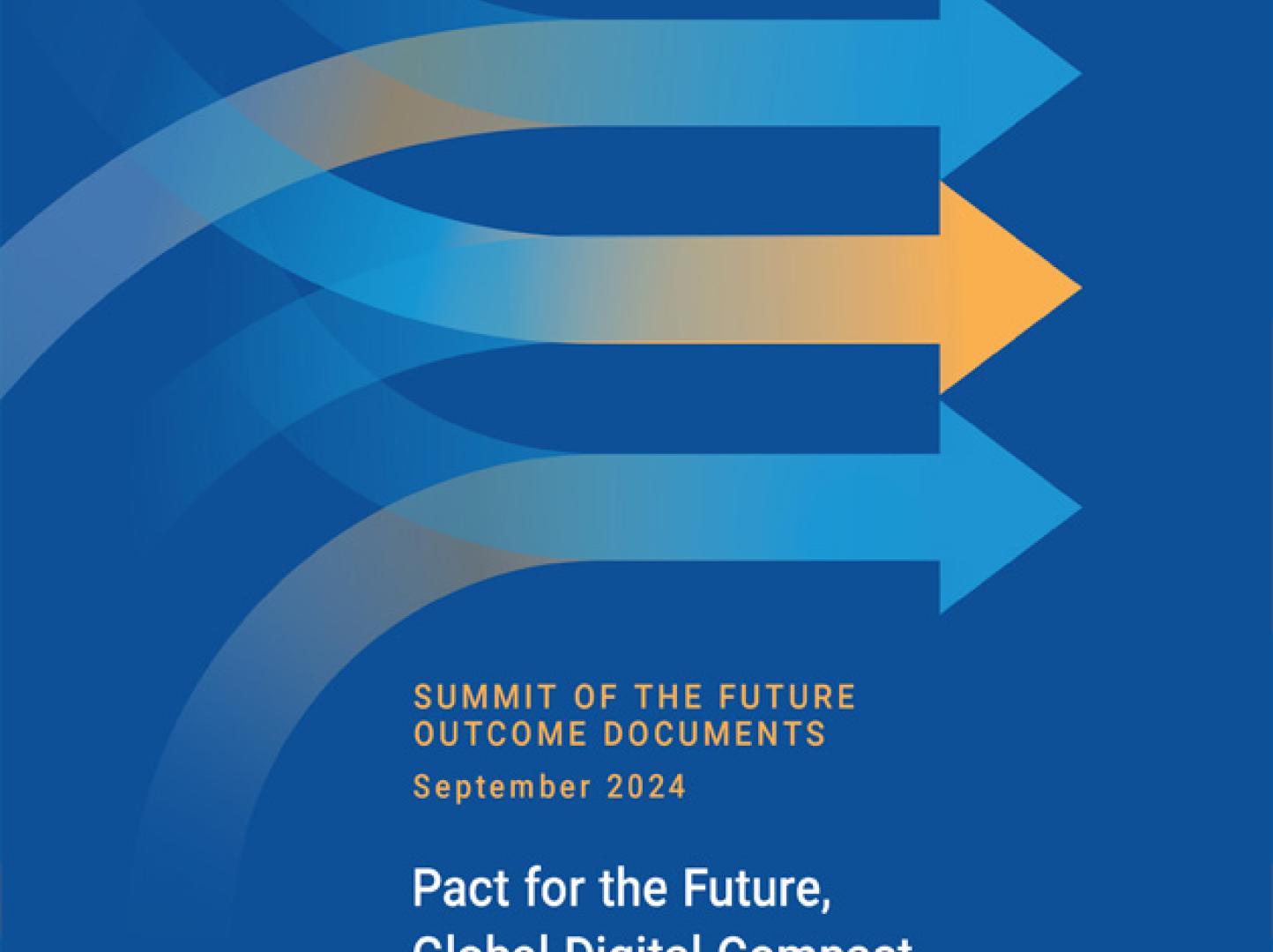Dernières actualités
Histoire
25 février 2026
Quand l’art donne voix au silence : des jeunes qui transforment la lutte contre les violences et les inégalités
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
18 février 2026
La Tunisie accélère la protection de la couche d’ozone avec le lancement de la phase finale du Plan de Gestion de l’Élimination des substances HCFC
Pour en savoir plus
Vidéo
05 février 2026
Projet JPRWEE Tunisie 1
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable en Tunisie
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs mondiaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU en Tunisie:
Communiqué de presse
04 février 2026
Le Secrétaire général : MESSAGE DIFFUSÉ À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE SIMUL’ONU 2026
En participant à une Simul’ONU, vous apprenez ce qu’il faut pour bâtir un monde meilleur :
La persévérance, la maîtrise des faits et le courage de s’ouvrir à d’autres perspectives, tout en donnant toujours la priorité aux besoins des plus vulnérables.
Partout dans le monde, des jeunes comme vous sont les moteurs du changement : ils militent, se mobilisent et s’engagent dans l’intérêt général.
Votre énergie et votre détermination m’inspirent. Continuez de mettre vos talents au service du bien.
À l’Organisation des Nations Unies, nous nous engageons à ouvrir davantage de portes aux jeunes pour qu’ils puissent contribuer aux décisions qui influent sur leur vie.
Certes, nous traversons une période difficile.
Mais c’est l’épreuve qui façonne les grands leaders.
Et je sais que certains de ces leaders sont dans cette salle aujourd’hui.
Merci de croire au pouvoir de la coopération mondiale.
Ensemble, nous pouvons bâtir un monde de dignité, de justice et de paix pour toutes et tous.
La persévérance, la maîtrise des faits et le courage de s’ouvrir à d’autres perspectives, tout en donnant toujours la priorité aux besoins des plus vulnérables.
Partout dans le monde, des jeunes comme vous sont les moteurs du changement : ils militent, se mobilisent et s’engagent dans l’intérêt général.
Votre énergie et votre détermination m’inspirent. Continuez de mettre vos talents au service du bien.
À l’Organisation des Nations Unies, nous nous engageons à ouvrir davantage de portes aux jeunes pour qu’ils puissent contribuer aux décisions qui influent sur leur vie.
Certes, nous traversons une période difficile.
Mais c’est l’épreuve qui façonne les grands leaders.
Et je sais que certains de ces leaders sont dans cette salle aujourd’hui.
Merci de croire au pouvoir de la coopération mondiale.
Ensemble, nous pouvons bâtir un monde de dignité, de justice et de paix pour toutes et tous.
1 / 5
Agir
02 janvier 2026
Agissons pour les Objectifs de Développement Durable
Agir pour notre avenir : 5 ans pour transformer les ODD en actions concrètes – alimentation, emplois, villes sûres, énergie propre, opportunités numériques. Chaque geste compte. Agissez dès maintenant avec ActNow !
1 / 5

Publication
24 janvier 2026
Lancement du Plan d’action stratégique pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans le milieu rural à l’horizon 2030
Entre le lancement d’un plan national ambitieux et une clôture solennelle assurée par la ministre de la Famille, cet événement marque l’aboutissement d’un plaidoyer sans précédent porté par ONU Femmes.Plus qu'un simple partenaire, ONU Femmes s'est imposée lors de ce séminaire comme le véritable trait d'union d'une ambition arabe partagée. En réunissant autour d’une même table la Tunisie, l'Oman, la Jordanie et l’Égypte, l'organisation a transformé un dialogue interrégional en un appel puissant : celui d’une stratégie unifiée pour que la femme rurale ne soit plus perçue comme une figure vulnérable, mais comme le moteur d'une économie moderne.Cette vision a trouvé son ancrage le plus concret avec le lancement du Plan National Stratégique d'Insertion Économique des Femmes et des Filles en Milieu Rural à l'horizon 2030. Porté par le programme mondial JP RWEE, ce plan n’est pas qu’un simple document administratif ; c’est une promesse de terrain. Il transforme l’aspiration à l’autonomie en une feuille de route rigoureuse, où chaque intention est désormais structurée, financée et prête à être déployée.Redessiner l'Avenir : Les Leviers Techniques de la TransformationDerrière cette ambition se cache une conviction profonde, sculptée par l’expertise technique d’ONU Femmes : les femmes rurales sont les gardiennes silencieuses de notre biodiversité et les piliers de notre sécurité alimentaire. Pour libérer leur potentiel, le Plan 2030 s'articule autour de quatre axes techniques fondamentaux, conçus pour briser les barrières structurelles :Réforme législative : pour aligner les politiques nationales sur les normes et standards internationaux.Accès aux ressources : afin de lever les barrières liées au financement, à la propriété foncière et aux moyens de production.Leadership et participation : pour renforcer la voix des femmes dans les instances de décision locales et territoriales.Économie verte et digitale : pour orienter les initiatives vers l’innovation, la durabilité et la transition écologique.En consolidant ces piliers, ONU Femmes et le ministère ne se contentent pas de soutenir des projets ; ils bâtissent un écosystème où la technologie et l'égalité des chances deviennent les nouveaux outils de la prospérité rurale.Un Engagement de l'État pour la Justice SocialeLa clôture de l'événement par Mme Asma El Jabri, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a marqué un point d'orgue politique fort. Elle a réaffirmé avec détermination que l’intégration économique des femmes rurales est une priorité absolue de la vision du Président de la République, M. Kaïs Saïed. En inscrivant cette démarche dans le cadre de la justice sociale et de l'égalité des chances, la ministre a présenté les recommandations du séminaire comme un levier essentiel pour bâtir des réseaux arabes d'échange d'expertises.Mme El Jabri a également profité de cette tribune pour saluer le courage des pionnières tunisiennes, mettant en lumière le succès de programmes structurants tels que « Raidaat » et les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. En rendant hommage aux entrepreneures venues de Monastir, Siliana et Médenine, elle a célébré l'innovation au féminin, particulièrement dans les secteurs d'avenir liés à l'économie verte, confirmant ainsi que la transition écologique tunisienne passera par l'autonomisation de ses territoires ruraux.Le séminaire de Tunis ne s’est pas limité à célébrer des acquis ; il a posé les fondations d’une coopération Sud-Sud renforcée, où la Tunisie, soutenue par ONU Femmes, s’impose comme un modèle régional. Comme l’a rappelé cet événement, investir dans une femme rurale, ce n’est pas seulement transformer une trajectoire individuelle : c’est impulser le changement pour une nation entière.Consultez le Plan d'action stratégique national pour l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans les zones rurales à l'horizon 2030 en arabe, en anglais et en français.
1 / 5
Publication
16 janvier 2026
Plan Stratégique d’Alimentation et de Nutrition des Enfants de 0 à 18 ans
UNICEF Tunisie/Mai 2025/Ahmad Kharoubi Points fortsL’UNICEF a accompagné le Ministère de la Santé dans l’élaboration du Plan Stratégique d’Alimentation et de Nutrition des Enfants 0–18 ans (PSANE), qui vise à promouvoir et protéger des pratiques, services et régimes alimentaires favorisant une nutrition optimale tout au long du cycle de vie. Ce plan accorde une attention particulière aux enfants, adolescents et femmes, considérés comme les groupes les plus vulnérables, et contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable. Il s’articule autour de quatre axes : la promotion de l’allaitement maternel et de l’alimentation complémentaire appropriée ; l’amélioration de la nutrition des enfants d’âge préscolaire et scolaire à travers la création d’environnements alimentaires sains et le renforcement de l’éducation nutritionnelle ; le dépistage précoce et la prise en charge des troubles nutritionnels chez les enfants, adolescents et femmes enceintes ou allaitantes ; enfin, le renforcement du cadre institutionnel, juridique et de gouvernance, incluant des mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation pour garantir l’atteinte des objectifs et permettre des ajustements continus. »
1 / 5
Communiqué de presse
23 janvier 2026
Renforcement du système de santé en Tunisie : Une alliance stratégique pour l’excellence de la pratique sage-femme
Renforcement du système de santé en Tunisie : Une alliance stratégique pour l’excellence de la pratique sage-femmeUn cheminement de longue haleine (2015-2023)Le processus a débuté dès 2015 sous l'égide de l'École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis (ESSTST). Face à l'urgence de définir une identité professionnelle claire, un premier projet a vu le jour, suivi d'une validation pédagogique en août 2018 impliquant 42 expert.es et praticien.nes. Pour répondre aux standards d'accréditation internationale, ce référentiel a été converti en 2021 en un référentiel de compétences, s'inspirant des normes de la Confédération internationale des sages-femmes (ICM). En 2023, la solidité du projet a été renforcée par une expertise externe menée par cinq spécialistes internationaux en gynécologie, droit de la santé et sciences maïeutiques.L'accélération institutionnelle et le succès final (2024-2026)Le tournant décisif a été pris entre 2024 et 2025 avec la mise à jour du référentiel de métier de sage femme. Ce travail de précision a bénéficié d'un partenariat stratégique avec l'Instance Nationale d’Évaluation et d’Accréditation en Santé (INEAS). Sous l'égide de l'INEAS et avec l'appui de l'UNFPA et de l'ATSF, une méthodologie rigoureuse a été déployée à travers cinq comités spécialisés.Après une phase de mise à jour cruciale en juin 2025 impliquant différents acteurs , le processus a abouti à la validation nationale officielle de novembre 2025.Un levier pour l'avenir du système de santéL'atelier de validation tenu à Tunis du 17 au 19 novembre 2025 témoigne d'une synergie exemplaire entre les agences onusiennes, les institutions publiques et la société civile. En clarifiant les missions et les attributions de la profession, ce référentiel devient le pivot de deux réformes majeures : la révision des programmes de formation universitaire et la modernisation du cadre législatif régissant la pratique sage-femme.A travers cet appui stratégique, le Système des Nations Unies, porté par l'expertise technique de l'UNFPA, réaffirme sa volonté de soutenir la Tunisie dans la consolidation d'un modèle de santé sexuelle et reproductive résilient. Cette avancée place durablement le bien-être des femmes et des nouveaux nés , au cœur des priorités nationales pour un avenir en santé.
1 / 5
Histoire
25 février 2026
Quand l’art donne voix au silence : des jeunes qui transforment la lutte contre les violences et les inégalités
Sur scène, des jeunes artistes racontent la violence, la charge invisible et le poids des normes sociales, transformant émotion et créativité en mobilisation. Ces dernières années, plusieurs initiatives soutenues par les Nations Unies en Tunisie mettent l’art au cœur de l’engagement communautaire et révèlent le rôle clé de la jeunesse pour construire des sociétés plus justes et égalitaires. Parmi ces initiatives, le court-métrage « Beyond Reality / Au-delà de la réalité », produit par ONU Femmes Tunisie et réalisé par Bechir Zayene, marque une étape importante, avec le soutien financier de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID). Lancé en 2024 à l’occasion de la Journée Nationale de la Femme tunisienne, le film a été présenté en avant-première à la Cité de la Culture à Tunis dans le cadre du projet « Tunis, Ville Sûre pour les Femmes et les Jeunes Filles ». Ce film poignant raconte l’histoire de Hayet, une jeune femme confrontée à des violences physiques, sexuelles, psychologiques et numériques, démontrant le rôle puissant de la création artistique comme levier de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation collective. Au-delà de son lancement national, Beyond Reality a été sélectionné et projeté dans de nombreux festivals internationaux, dont les JCC, le Human Screen Festival, le World Urban Forum, les Rome Prisma Film Awards, le Dubai Independent Film Festival, le Madrid Film Festival et le Paris Short Film Festival. À El Kef, à Gabès, dans les ruelles de la médina de Tunis, d’autres scènes se sont ouvertes. Les résidences artistiques Production Invisible : 8:45 – “Dare to Care”, lancées en janvier 2025 par ONU Femmes dans le cadre de son initiative phare Dare to Care, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont invité de jeunes artistes à explorer un autre silence : celui du travail de soin non rémunéré. Pendant plusieurs jours, artistes et mentors ont déconstruit normes et stéréotypes, transformant données et vécus en créations artistiques. À El Kef, « Intouchables » a révélé la charge mentale féminine, suscitant des échanges ouverts avec le public. À Gabès, le rap « Wisdom » a questionné les modèles de masculinité et promu un partage équitable des responsabilités. À Tunis, l’exposition immersive « Women Carry War in Their Bodies » a illustré les traces des violences et des inégalités. Le 8 mars, toutes ces voix se sont réunies dans la performance collective Production Invisible 8:45, mêlant théâtre, rap et arts visuels pour dénoncer l’invisibilité du travail de care. Depuis mars, ces œuvres circulent dans festivals, universités et centres culturels, transformant les spectateurs en participants actifs : débattant, partageant et prenant conscience. Du grand écran aux scènes régionales, des festivals internationaux aux amphithéâtres tunisiens, une même énergie traverse ces initiatives : faire de l’art un espace où le silence se brise, l’invisible prend forme et la jeunesse devient actrice du changement. Quelques mois plus tard, dans un autre espace scénique à Tunis, le théâtre devient à nouveau un outil de compréhension, de prévention et de changement.En partenariat avec l’UNFPA et de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme, dans le cadre du programme EMNA financé par l'Union Européenne, de jeunes comédien·ne·s ont été formé·e·s aux violences basées sur le genre facilitées par la technologie : cyberharcèlement, diffusion d’images intimes sans consentement, chantage numérique. De cette prise de conscience est née la pièce Ce qui nous lie, dirigé par le réalisateur Walid Ayadi et co-écrite à partir de témoignages réels. Jouée devant près de 150 spectateurs, elle plonge le public dans des situations familières, parfois dérangeantes, souvent tues. « Le théâtre est la clé de la compréhension et du changement », souligne Walid Ayadi. La performance a été déplacée dans plusieurs lieux pour toucher un public plus large durant les 16 jours d’activisme. « Les violences basées sur le genre facilitées par la technologie (TFGBV) ne se limitent pas au monde numérique ; l’espace physique, hors ligne, fait tout autant partie de cette réalité. » Souligne Dr. Rym Fayala, Cheffe de bureau, UNFPA Tunisie « Il est essentiel d’aborder cette problématique sous ses deux dimensions. L’art s’impose ici comme une force transformatrice : un outil de prévention, un catalyseur de sensibilisation et un moteur de changement social. C’est à l’intersection de ces dynamiques puissantes que la performance “Binetna Rabet” trouve tout son sens et sa raison d’être. » À l’approche de 2030, ces initiatives rappellent que les ODD ne prennent sens que dans la réalité : l’égalité de genre, l’éducation et des sociétés inclusives se concrétisent lorsque les jeunes créent, questionnent et mobilisent. Ces histoires montrent que le changement est en marche et que, pour les cinq prochaines années cruciales de l’Agenda 2030, il est temps de s’engager activement afin que chaque communauté agisse pour bâtir des sociétés plus égalitaires. Rejoignez la mobilisation et découvrez comment participer à la campagne
1 / 5

Histoire
26 janvier 2026
Façonner l'avenir : des femmes qui allient tradition et innovation
Le travail, répétitif et exigeant, lui a permis de découvrir le monde de l'artisanat. Observatrice et déterminée, Mariem entrevoyait un potentiel au-delà des murs de l'usine, une vision qui allait donner naissance à Touka Création, une entreprise sociale dédiée à l'émancipation des femmes et à la renaissance de l'art traditionnel du tissage Halfa. Le halfa, une plante résistante originaire d'Afrique du Nord, est utilisé depuis longtemps par les artisans pour confectionner des paniers, des nattes et des objets décoratifs. Au fil du temps, cet artisanat traditionnel a cependant commencé à disparaître, supplanté par la production de masse. Mariem a perçu la beauté et le potentiel du halfa, imaginant une manière d'allier les techniques ancestrales au design moderne, préservant ainsi la culture tout en créant des moyens de subsistance. Son rêve a commencé à se concrétiser grâce au soutien du projet « Tunisie créative », mis en œuvre par l’ONUDI et financé par l’Union européenne, avec une contribution de l’Agence italienne pour la coopération au développement. Par le biais de formations, d’un accompagnement technique et d’un développement commercial, Mariem a transformé son idée en une entreprise pérenne. Grâce au soutien du projet, elle a créé un atelier de 80 mètres carrés à Kasserine, équipé de machines modernes. Cet espace est devenu bien plus qu'un simple lieu de travail : un véritable centre communautaire où les femmes du quartier pouvaient apprendre, collaborer et trouver un nouveau sens à leur vie. Ce qui n'était au départ qu'une idée a donné naissance à un réseau de 68 artisanes, dont beaucoup ont été formées grâce au projet, générant un chiffre d'affaires de plus de 300 000 dinars tunisiens. Guidée par Creative Tunisia, Mariem a collaboré avec trois créateurs pour concevoir une collection inspirée du Halfa, alliant tradition et innovation. Présentée à la galerie Musk and Amber, puis lors de salons nationaux à travers la Tunisie, la collection a bénéficié d'une nouvelle stratégie de marketing digital qui a permis à Touka Création d'accroître sa visibilité et d'accéder à des marchés plus vastes. Aujourd'hui, Touka Création est un symbole de créativité, d'inclusion et de résilience. Mariem ambitionne d'élargir sa gamme de produits, de conquérir les marchés internationaux et d'ouvrir davantage de centres de formation pour les femmes rurales. Pour elle, l'aventure ne fait que commencer. « Je souhaite que les jeunes femmes de Kasserine et d'ailleurs sachent qu'avec passion et persévérance, il est possible d'instaurer un véritable changement », déclare-t-elle. « Nos traditions ne sont pas des vestiges du passé, mais des ressources. En les honorant, nous bâtissons un avenir empreint de fierté et de sens. » Pour plus d'informations, veuillez contacter le Bureau des communications, des conférences et des relations avec les médias.
1 / 5

Histoire
16 janvier 2026
Du patrimoine aux horizons : porter la tradition à la conquête du monde
Répondant aux normes internationales et inspirant une nouvelle génération de femmes entrepreneures. À l'instar de nombreux petits entrepreneurs de la région, elle puisait son inspiration dans le riche patrimoine naturel tunisien tout en mettant en valeur les produits locaux.Pour répondre aux obstacles et aux défis plus larges qui entravent l'autonomisation économique des femmes, l'ONUDI a lancé un projet pilote en Tunisie visant à améliorer l'accès au marché des entreprises dirigées par des femmes dans les secteurs des cosmétiques naturels et des produits parapharmaceutiques. Ce projet a été financé par le gouvernement de la Principauté de Monaco dans le cadre du projet « Promotion de l'autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusif et durable » (PWE) dans la région MENA, labellisé par l'Union pour la Méditerranée (UpM).« Avant le projet PWE, nos processus de production étaient moins structurés, ce qui limitait notre capacité et notre accès aux marchés internationaux, malgré notre engagement envers la qualité », se souvient Bouchra. « L’absence de normes internationalement reconnues constituait un obstacle majeur. Sans certification, il était quasiment impossible de nous développer au-delà des frontières locales et régionales. »Grâce à une série d'interventions stratégiques, le projet pilote PWE a réalisé des progrès significatifs, notamment en permettant l'obtention de la certification ISO 22716, norme internationale de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les cosmétiques. Un partenariat multipartite entre l'ONUDI, le Centre technique chimique (CTC) et le ministère tunisien de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines a permis de rationaliser le processus de certification.
Pour l'entreprise de Bouchra, Bahia Cosmetic, la certification ISO 22716 a représenté un pas en avant significatif car elle garantissait la transparence, la traçabilité et la qualité en alignant l'entreprise sur les normes internationales.« Grâce au renforcement des connaissances et des capacités, à la mise en réseau, à la sensibilisation et à l'assistance technique, le projet PWE a permis d'assurer la conformité et de libérer notre potentiel » , a déclaré Bouchra. « Aujourd'hui, Bahia Cosmetics n'est plus limitée par les frontières. Les produits qui s'adressaient autrefois à une clientèle locale bénéficient désormais d'une crédibilité suffisante pour toucher des clients du monde entier. »Le succès de Bouchra illustre la mission plus large du projet PWE : promouvoir un développement industriel durable et inclusif en fournissant aux femmes les outils, les connaissances et les réseaux nécessaires à leur épanouissement. Qu’il s’agisse de compétences techniques renforcées, d’une meilleure qualité des produits ou d’une plus grande visibilité sur le marché, des initiatives comme celle-ci transforment les mentalités, passant de l’exclusion à l’autonomisation et du local au global.Pour plus d'informations, veuillez contacter le Bureau des communications, des conférences et des relations avec les médias.
Pour l'entreprise de Bouchra, Bahia Cosmetic, la certification ISO 22716 a représenté un pas en avant significatif car elle garantissait la transparence, la traçabilité et la qualité en alignant l'entreprise sur les normes internationales.« Grâce au renforcement des connaissances et des capacités, à la mise en réseau, à la sensibilisation et à l'assistance technique, le projet PWE a permis d'assurer la conformité et de libérer notre potentiel » , a déclaré Bouchra. « Aujourd'hui, Bahia Cosmetics n'est plus limitée par les frontières. Les produits qui s'adressaient autrefois à une clientèle locale bénéficient désormais d'une crédibilité suffisante pour toucher des clients du monde entier. »Le succès de Bouchra illustre la mission plus large du projet PWE : promouvoir un développement industriel durable et inclusif en fournissant aux femmes les outils, les connaissances et les réseaux nécessaires à leur épanouissement. Qu’il s’agisse de compétences techniques renforcées, d’une meilleure qualité des produits ou d’une plus grande visibilité sur le marché, des initiatives comme celle-ci transforment les mentalités, passant de l’exclusion à l’autonomisation et du local au global.Pour plus d'informations, veuillez contacter le Bureau des communications, des conférences et des relations avec les médias.
1 / 5

Histoire
16 janvier 2026
Des femmes engagées au cœur de la transformation des systèmes de santé
Mais derrière chaque soin, une chaîne invisible agit en silence : des équipements performants, des professionnel·le·s formé·e·s, et une gestion rigoureuse des déchets post-traitement. En Tunisie, cette chaîne prend forme à travers des femmes et des hommes engagé·e·s, qui œuvrent chaque jour pour une santé publique plus sûre, équitable et durable. Au cœur de cet effort, 2 500 professionnel·le·s de santé ont vu leurs compétences renforcées grâce à un projet financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par UNOPS, visant à améliorer les soins et les conditions de vie des patient·e·s. Cet appui humain s’accompagne de matériel moderne : près de 1 800 équipements de haute technologie ont été déployés dans plus de 75 hôpitaux, améliorant directement l’expérience des patient·e·s. « Le renforcement des systèmes de santé passe autant par des équipements de pointe que par l’investissement dans les compétences humaines qui les font vivre », souligne Nathalie Angibeau, Représentante d’UNOPS en Tunisie. À l’Hôpital Charles-Nicolle de Tunis, l’installation d’une nouvelle machine de lithotripsie extracorporelle (LEC) marque une avancée concrète dans le traitement des calculs rénaux. «Dès la première séance, les patients ont ressenti moins de douleur et plus de confort », témoigne Khouloud Titouhi, technicienne supérieure en imagerie médicale et radiothérapie. Ces efforts ont permis également des économies substantielles — plus de 4,2 millions de dollars — réinvestis pour moderniser encore davantage le système de santé et introduire de nouvelles spécialités, renforçant la résilience du pays face aux chocs sanitaires futurs. À l’autre bout de la chaîne, des initiatives locales complètent l’action des institutions. Sondouss Bannouri, entrepreneure, a fondé DASRI STÉRILE pour collecter, transporter et traiter les déchets médicaux dangereux issus des hôpitaux et laboratoires. Avec le soutien du programme Mashrou3i et de l’ONUDI, Sondouss a affiné son modèle économique, intégré des pratiques respectueuses de l’environnement et créé des emplois dans un secteur à fort potentiel, notamment dans la région de Siliana.Sa démarche montre que rendre la santé publique durable ne se limite pas à moderniser les hôpitaux: il faut aussi gérer de façon responsable les ressources et les déchets, tout en mobilisant les communautés et l’innovation locale. Investir dans la santé, c’est bien plus que soigner des maladies : c’est préserver la vie pour aujourd’hui et demain, tout en protégeant l’environnement et en donnant aux citoyen·ne·s les moyens de construire un avenir plus équitable et résilient. Ces initiatives concrètes menées sur le terrain illustrent l’importance d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable, en l'occurrence ici “l’ODD 3 – Bonne santé et bien-être”, avant la fin de l’Agenda 2030. En montrant que des solutions efficaces existent, elles incarnent l’esprit de mobilisation et d’action de la campagne “5 Years For”, invitant toutes et tous à contribuer activement à un futur durable et inclusif. https://tunisia.un.org/fr/take-action
1 / 5

Histoire
20 décembre 2025
Yoser Abdeldayem: Quand l’inclusion et le climat se rencontrent
Étudiante en langue des signes, elle consacre depuis son adolescence son énergie à la lutte contre les changements climatiques et la protection de l’environnement. Tout a commencé à l’âge de 13 ans, lorsqu’elle commence à s’intéresser par les sujets de l’environnement à travers son engagement associatif ; elle décide de créer Manarat Douz FM, une radio régionale destinée à sensibiliser les habitants de sa région aux enjeux environnementaux. Aujourd’hui, Manarat Douz FM est reconnue comme la voix du climat et de la jeunesse de sa région, un espace où l’on parle de climat, de développement local et d’avenir durable. Engagée sur plusieurs fronts, Yoser est également coordinatrice régionale du ‘Participatory Action Research’ à Kébili, où elle mobilise d’autres jeunes autour de projets de sensibilisation et d’actions écologiques. Sa détermination et sa soif d’apprendre la poussent à participer à de nombreuses formations sur l’environnement et les changements climatiques, afin de renforcer ses connaissances, notamment sur le plan technique. Yoser consacre aussi beaucoup de temps à la recherche personnelle. Elle s’intéresse à des sujets complexes et innovants liés à la crise climatique, cherchant sans cesse à mieux comprendre les défis de notre époque. « Au début, comme beaucoup de jeunes, les changements climatiques n’étaient pour moi qu’un terme technique que j’entendais souvent. Mais en approfondissant mes connaissances sur le sujet, j’ai compris qu’il s’agit d’un enjeu beaucoup plus profond, qui nous concerne tous. J’en ressens moi-même les effets dans ma vie quotidienne : des journées de plus en plus chaudes qui rendent les déplacements et les études difficiles, une fatigue accrue, la surconsommation d’électricité à cause de la climatisation et une inquiétude grandissante face à l’avenir. Ces expériences m’ont fait prendre conscience de l’urgence d’agir et ont renforcé ma conviction que la jeunesse doit être au cœur de la réponse climatique.» Mais ce qui rend le parcours de Yoser unique, c’est sa volonté d’inclure dans ce combat une communauté souvent oubliée : les personnes sourdes. Elle s’est rendu compte qu’aucun geste n’existait pour traduire des mots comme atténuation, résilience ou neutralité carbone. Dans le cadre de son projet de fin d’étude cette année, Yoser a commencé à inventer des nouveaux gestes pour rendre ces notions accessibles aux jeunes sourds, leur permettant ainsi de mieux comprendre et de participer, eux aussi, aux discussions sur le climat. C’est dans cette même dynamique qu’elle découvre l’appel à candidatures de l’initiative Jeunesse 3.0. Cette initiative, portée par le Ministère de l’environnement (à travers l'Unité Nationale de Coordination sur les Changements Climatiques), le Ministère de la jeunesse et des sports, avec l’appui du PNUD et de l'UNICEF, mobilise les jeunes pour co-construire la troisième Contribution Déterminée au niveau National (CDN3.0) et les politiques climatiques, en renforçant leurs compétences, en valorisant leurs idées et en favorisant une gouvernance participative pour une transition écologique inclusive et durable. D’abord hésitante, elle finit par déposer sa candidature, portée par sa passion et son envie d’élargir son impact. Pour elle, cette initiative est une chance d’apprendre, de partager et de faire entendre la voix de la jeunesse du Sud, mais aussi celle de l’inclusion. Cette rencontre lui a permis de voir comment les jeunes de sa région, aux côtés des représentants régionaux de différents secteurs, transforment les défis climatiques en opportunités entrepreneuriales, à travers des initiatives durables dans l’agriculture, le recyclage ou les énergies renouvelables. Elle y a renforcé ses connaissances techniques, mieux compris les politiques climatiques nationales et gagné en confiance, tout en élargissant son réseau au sein de la jeune communauté engagée pour le climat. “J’étais très heureuse de voir des représentants de différents secteurs assis avec nous, les jeunes. Ces échanges intersectoriels et intergénérationnels m’ont beaucoup appris. J’ai même découvert des problèmes liés aux changements climatiques dans ma région que je ne connaissais pas auparavant.” Aujourd’hui, Youser se projette vers l’avenir avec une vision claire : continuer à œuvrer pour un monde plus inclusif et plus durable. Elle souhaite approfondir son engagement à l’échelle internationale et travailler sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’action climatique. « Le changement commence par la connaissance, mais il se construit par la participation de tous, sans exception », affirme-t-elle avec conviction.
1 / 5

Communiqué de presse
18 février 2026
La Tunisie accélère la protection de la couche d’ozone avec le lancement de la phase finale du Plan de Gestion de l’Élimination des substances HCFC
Ce programme de transition vers les nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, s'inscrit dans une dynamique historique : depuis 1993, l'ONUDI, avec l'appui du Fonds Multilatéral, soutient plus de 100 pays pour réduire l'usage des substances nocives pour l'ozone. En Tunisie, cet engagement se concrétise par la mise en œuvre des projets Protocole de Montréal et de l’Amendement de Kigali, coordonnés par l’ANPE en partenariat avec l'ONUDI et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement).
Après le succès en Tunisie des deux premières phases (2014 - 2026), marquées par une réduction de 70% de ces substances et ayant permis à de nombreuses entreprises tunisiennes de réussir leur transition écologique et technologique, cette nouvelle phase (2026 –2030) vise l'élimination totale des HCFC d'ici 2030.« Cette nouvelle phase ne se contente pas d'éliminer simplement des substances nocives à la couche d’ozone; elle vise à transformer durablement le secteur tunisien du froid pour le rendre plus performant et respectueux de l'environnement. C’est un signal fort pour nos industriels : la transition vers des technologies propres est désormais une réalité opérationnelle », a souligné M. Youssef Hammami, Coordinateur de l’Unité Nationale d’Ozone (ANPE). Enjeux et priorités de la Phase III (2026-2030) La Phase III, dotée d'un budget de 1,12 million de dollars financé par le Fonds multilatéral, prévoit des actions concrètes pour ramener la consommation nationale de ces substances HCFC à zéro à l’horizon de 2030 :Instauration et mise en œuvre d’un programme national de récupération, recyclage et régénération (RRR) des fluides frigorigènes contrôlés par le protocole de Montréal,Equipements, Formation, et renforcement des capacités :Formation des techniciens, commerciaux, ingénieurs conseils et architectes sur les nouvelles technologies alternatives, et mise en œuvre d’un programme national pour la certification des techniciens et des sociétés de service opérant dans le secteur du froid ;Réhabilitation du Centre Sectoriel de Formation en Énergétique de Kairouan afin d’assurer la formation à l’utilisation des réfrigérants naturels (Ammoniac, CO2, absorption), en tant qu’alternatives sans danger pour l'atmosphère.Soutien aux centres de formation professionnelles avec des équipements et outillages servant pour promouvoir les bonnes pratiques de gestion des fluides frigorigènes.Octroi de bourses d'études pour encourager l’intégration des femmes dans les métiers du froid.Projets pilotes dans les secteurs clésDe la pêche à travers des projets pilotes dans les ports tunisiens visant à moderniser les équipements de réfrigération à l’aide de réfrigérants naturels, et à promouvoir les bonnes pratiques de maintenance afin de prévenir les fuites.De l’industrie agroalimentaire à travers des projets pilotes démontrant des nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, avec dissémination des résultats de ces projets à l’ensemble des entreprises du secteur.Soulignant l’importance de cette phase finale, M. Benoît Wuatelet - Expert International au siège de l'ONUDI à l’unité Protocole de Montréal, a déclaré : « Cette phase finale vise à accompagner les acteurs nationaux dans l’adoption de technologies alternatives à faible impact climatique, en tenant compte des contraintes économiques et opérationnelles du secteur. »A propos de l’ONUDIL'ONUDI est une agence spécialisée des Nations Unies, dont le mandat unique est de promouvoir, dynamiser et accélérer le développement industriel inclusif et durable. L'ONUDI, la couche d'ozone et le protocole de Montréal La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère terrestre qui absorbe la plupart des rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil. L'utilisation de chlorofluorocarbones (CFC) dans les bombes aérosols, la réfrigération, la climatisation et le secteur des mousses a été identifiée comme la cause de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Le Protocole de Montréal a tracé la voie pour l’élimination progressive des CFC et de près de 100 autres substances chimiques fabriquées par l’homme et responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone (SAO). Les hydrofluorocarbures (HFC) ont ensuite été introduits comme substituts aux CFC et aux HCFC. Bien que les HFC n’appauvrissent pas la couche d’ozone, ce sont de puissants gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.
L’ONUDI est l’une des quatre agences chargées de la mise en œuvre du Protocole de Montréal et se trouve à l’avant-garde de l’action climatique. L’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, entré en vigueur en 2019, vise à réduire progressivement les HFC. On estime que la mise en œuvre complète de l’Amendement de Kigali, combinée à des mesures d’efficacité énergétique accrues, pourrait éviter jusqu’à 0,5 °C de réchauffement climatique d’ici 2100. Personnes à contacter :
Hela Ghedira
Experte Nationale en Communication à l’ONUDI
h.ghedira@unido.org - +216 93 123 268 Youssef Hammami
Coordinateur National du projet Protocole de Montréal à l’ONUDI
youssefhamami@yahoo.fr
Après le succès en Tunisie des deux premières phases (2014 - 2026), marquées par une réduction de 70% de ces substances et ayant permis à de nombreuses entreprises tunisiennes de réussir leur transition écologique et technologique, cette nouvelle phase (2026 –2030) vise l'élimination totale des HCFC d'ici 2030.« Cette nouvelle phase ne se contente pas d'éliminer simplement des substances nocives à la couche d’ozone; elle vise à transformer durablement le secteur tunisien du froid pour le rendre plus performant et respectueux de l'environnement. C’est un signal fort pour nos industriels : la transition vers des technologies propres est désormais une réalité opérationnelle », a souligné M. Youssef Hammami, Coordinateur de l’Unité Nationale d’Ozone (ANPE). Enjeux et priorités de la Phase III (2026-2030) La Phase III, dotée d'un budget de 1,12 million de dollars financé par le Fonds multilatéral, prévoit des actions concrètes pour ramener la consommation nationale de ces substances HCFC à zéro à l’horizon de 2030 :Instauration et mise en œuvre d’un programme national de récupération, recyclage et régénération (RRR) des fluides frigorigènes contrôlés par le protocole de Montréal,Equipements, Formation, et renforcement des capacités :Formation des techniciens, commerciaux, ingénieurs conseils et architectes sur les nouvelles technologies alternatives, et mise en œuvre d’un programme national pour la certification des techniciens et des sociétés de service opérant dans le secteur du froid ;Réhabilitation du Centre Sectoriel de Formation en Énergétique de Kairouan afin d’assurer la formation à l’utilisation des réfrigérants naturels (Ammoniac, CO2, absorption), en tant qu’alternatives sans danger pour l'atmosphère.Soutien aux centres de formation professionnelles avec des équipements et outillages servant pour promouvoir les bonnes pratiques de gestion des fluides frigorigènes.Octroi de bourses d'études pour encourager l’intégration des femmes dans les métiers du froid.Projets pilotes dans les secteurs clésDe la pêche à travers des projets pilotes dans les ports tunisiens visant à moderniser les équipements de réfrigération à l’aide de réfrigérants naturels, et à promouvoir les bonnes pratiques de maintenance afin de prévenir les fuites.De l’industrie agroalimentaire à travers des projets pilotes démontrant des nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, avec dissémination des résultats de ces projets à l’ensemble des entreprises du secteur.Soulignant l’importance de cette phase finale, M. Benoît Wuatelet - Expert International au siège de l'ONUDI à l’unité Protocole de Montréal, a déclaré : « Cette phase finale vise à accompagner les acteurs nationaux dans l’adoption de technologies alternatives à faible impact climatique, en tenant compte des contraintes économiques et opérationnelles du secteur. »A propos de l’ONUDIL'ONUDI est une agence spécialisée des Nations Unies, dont le mandat unique est de promouvoir, dynamiser et accélérer le développement industriel inclusif et durable. L'ONUDI, la couche d'ozone et le protocole de Montréal La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère terrestre qui absorbe la plupart des rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil. L'utilisation de chlorofluorocarbones (CFC) dans les bombes aérosols, la réfrigération, la climatisation et le secteur des mousses a été identifiée comme la cause de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Le Protocole de Montréal a tracé la voie pour l’élimination progressive des CFC et de près de 100 autres substances chimiques fabriquées par l’homme et responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone (SAO). Les hydrofluorocarbures (HFC) ont ensuite été introduits comme substituts aux CFC et aux HCFC. Bien que les HFC n’appauvrissent pas la couche d’ozone, ce sont de puissants gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.
L’ONUDI est l’une des quatre agences chargées de la mise en œuvre du Protocole de Montréal et se trouve à l’avant-garde de l’action climatique. L’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, entré en vigueur en 2019, vise à réduire progressivement les HFC. On estime que la mise en œuvre complète de l’Amendement de Kigali, combinée à des mesures d’efficacité énergétique accrues, pourrait éviter jusqu’à 0,5 °C de réchauffement climatique d’ici 2100. Personnes à contacter :
Hela Ghedira
Experte Nationale en Communication à l’ONUDI
h.ghedira@unido.org - +216 93 123 268 Youssef Hammami
Coordinateur National du projet Protocole de Montréal à l’ONUDI
youssefhamami@yahoo.fr
1 / 5
Communiqué de presse
26 janvier 2026
Message du Secrétaire général á l’occasion de la Journée internationale des énergies propres
Les énergies renouvelables peuvent être le moteur de cette transition. Dans la plupart des régions, elles sont la source d’énergie nouvelle la plus abordable. Et l’année dernière, pour la première fois, l’énergie éolienne, l’énergie solaire et d’autres sources renouvelables ont produit plus d’électricité dans le monde que le charbon. Les énergies renouvelables permettent de desservir des populations encore plongées dans l’obscurité, de cuisiner de manière propre et d’améliorer la santé et l’éducation, tout en ouvrant de meilleures perspectives. Elles favorisent l’émergence de nouvelles industries, créent des emplois décents, réduisent les coûts énergétiques et permettent aux pays de se prémunir contre les chocs géopolitiques et l’instabilité des marchés. Cependant, la révolution des énergies renouvelables ne va pas assez vite ni suffisamment loin. Les infrastructures de réseau sont loin de suivre l’accroissement des capacités en matière d’énergie propre, et le niveau élevé des coûts fait que de nombreux pays demeurent entièrement exclus de la transition. La voie à suivre est claire : nous devons tripler la capacité mondiale de production d’énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2030, en levant les obstacles, en réduisant les coûts et en raccordant les populations et les industries à l’énergie propre par une action rapide, solidaire et de grande ampleur. Les organismes de réglementation doivent adopter des politiques qui récompensent les énergies propres et simplifient les procédures d’autorisation tout en protégeant les populations et l’environnement. Les entreprises de services publics doivent moderniser, élargir et numériser les réseaux et les interconnexions afin d’acheminer l’énergie propre là où elle est nécessaire, et adapter le stockage afin que les systèmes électriques restent stables à mesure que les énergies renouvelables se développent. Le secteur de l’énergie doit diversifier ses chaînes d’approvisionnement afin que davantage de pays puissent mettre au point, installer et entretenir des systèmes d’énergie propre. Cela inclut les minéraux critiques essentiels à la transition, qui doivent profiter aux pays et aux communautés qui les produisent, et pas seulement aux marchés mondiaux. Le secteur financier doit réduire le coût du capital, en particulier pour les pays en développement qui ont un énorme potentiel en matière d’énergies renouvelables. Et les banques multilatérales de développement doivent réduire les risques et débloquer des investissements privés beaucoup plus conséquents. Plus important encore, nous devons veiller à ce que cette transition soit équitable, en protégeant les travailleurs et travailleuses et les communautés, en promouvant l’éducation et le développement industriel et en offrant des chances égales à toutes et tous à mesure que les systèmes énergétiques évoluent. L’énergie propre est à notre portée. Saisissons cette occasion pour propager la révolution des énergies renouvelables aux quatre coins du monde.
1 / 5
Communiqué de presse
17 janvier 2026
Lancement des travaux de l'installation de l'unité de méthanisation à Djerba
Conçue pour traiter environ 6 000 tonnes de déchets organiques par an, l’unité permettra de produire près de 1 600 MWh d’électricité renouvelable par an, d’éviter environ 5 600 tonnes d’équivalent CO₂ par an, et de générer près de 3 900 tonnes de digestat, contribuant à l’amélioration de la fertilité des terres agricoles.Le projet constitue une initiative pilote à fort impact environnemental, énergétique et agricole, et servira de plateforme de démonstration et de formation pour les collectivités locales et le secteur privé.Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale favorable au développement du biogaz, renforcée par l’adoption en 2025 du cadre tarifaire de rachat de l’électricité produite à partir du biogaz, fixé à 307 millimes par kWh. À travers ce projet, l’ANGED et l’ANME, avec l’appui du PNUD contribuent à structurer une filière stratégique, appelée à être mise à l’échelle au niveau national.
1 / 5
Communiqué de presse
11 décembre 2025
Clôture des 16 Jours d’activisme : Un engagement renouvelé pour un avenir numérique et économique sûr pour les femmes
L’événement de clôture a permis de présenter les principaux résultats de la campagne, de partager les bonnes pratiques et de réaffirmer l’engagement collectif pour un espace numérique sûr et inclusif. Des allocutions ont été prononcées par Mme Monica Noro, Coordinatrice résidente a.i. des Nations Unies en Tunisie, S.E. Teemu Sepponen, Ambassadeur de Finlande, et Mme Nyaradzayi Gumbonzvanda, Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes. Le programme a été marqué par une présentation synthétique des résultats, suivie de performances culturelles valorisant la créativité de jeunes artistes engagé·e·s contre les violences numériques.Tout au long des 16 jours, les agences des Nations Unies (notamment ONU Femmes, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC, OIM) ont déployé des actions coordonnées à travers le pays : activités de sensibilisation dans plusieurs gouvernorats, formations pour un traitement médiatique éthique, initiatives artistiques, ainsi qu’une campagne numérique touchant plus d’un million de personnes. Moment phare de la mobilisation, la « 5KM Run for Digital Safety » sur l’Avenue Habib Bourguiba a rassemblé des citoyen-ne-s, des membres de la communauté diplomatiques et équipes onusiennes pour appeler à un espace numérique exempt de violence. Cette campagne réaffirme la nécessité de renforcer la prévention, la protection et la solidarité afin de garantir à chaque femme et chaque fille un environnement numérique sûr et respectueux de leurs droits. Pour toute demande d’information, merci de contacter :
Mme Raouia Zaanouni, Analyste de communication à ONU Femmes Tunisie et Libye : raouia.zaanouni@unwomen.org
Mme Raouia Zaanouni, Analyste de communication à ONU Femmes Tunisie et Libye : raouia.zaanouni@unwomen.org
1 / 5
Communiqué de presse
27 novembre 2025
Lancement de la Campagne Nationale Conjointe des Nations Unies en Tunisie « Uni.e.s contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles »
Alors que 60% des femmes [1]en Tunisie déclarent avoir subi des violences facilitées par la technologie (Rapport du UNFPA, 2023), les formes les plus courantes incluent le harcèlement sexuel et le harcèlement en ligne. De plus, les technologies émergentes, y compris l’intelligence artificielle, accélèrent l’apparition de nouvelles formes inédites d’abus, telles que les « deepfakes », avec des répercussions directes dans la vie réelle.Coordonnée par ONU Femmes Tunisie, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la campagne se déploie dans la plupart des régions du pays à travers plus de 40 initiatives de formation, de plaidoyer et de sensibilisation communautaire, en partenariat avec les institutions publiques, la société civile et les jeunes. Parmi les moments phares figurent, les ateliers “AmenTech” d’ONU Femmes, les représentations théâtrales du FNUAP, les formations du PNUD destinées aux unités spécialisées, ainsi que la course nationale “5KM Run for Digital Safety” prévue le 7 décembre à Tunis. Le partenariat avec Orange Tunisie constitue également un axe majeur pour promouvoir un cyberespace plus sûr. La campagne se clôturera le 10 décembre par une rencontre nationale de haut niveau présentant les résultats et les engagements futurs. Nous vous invitons à vous engager activement dans le programme d'activités diffusé chaque jour sur nos réseaux sociaux (Nations Unies Tunisie). Ensemble, agissons concrètement, chacun.e à son niveau, pour lutter contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles et promouvoir un changement de comportement profond et durable. Pour toute demande d’information, merci de contacter :
Mme Raouia Zaanouni, Analyste de communication à ONU Femmes Tunisie et Libye : raouia.zaanouni@unwomen.org
[1] FNUAP. (2023). Les violences fondées sur le genre facilitées par la technologie en tunisie.
Mme Raouia Zaanouni, Analyste de communication à ONU Femmes Tunisie et Libye : raouia.zaanouni@unwomen.org
[1] FNUAP. (2023). Les violences fondées sur le genre facilitées par la technologie en tunisie.
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
05 février 2026
Ressources
05 février 2026
Ressources
28 septembre 2023
1 / 11